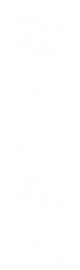Rencontre A.P.D.E.N. / SNES-FSU
20 décembre 2017
L’A.P.D.E.N. mène actuellement une série de rencontres avec les différents syndicats d’enseignant.e.s de l’Éducation nationale, visant à identifier divergences et convergences de points de vue, afin de faire émerger les revendications qui pourraient être portées conjointement. Dans ce contexte, le mercredi 20 décembre 2017, Gaelle Sogliuzzo, présidente de l’A.P.D.E.N. et Camille Ducrot, membre du bureau national de l’A.P.D.E.N., ont rencontré le SNES-FSU, parallèlement engagé dans un cycle d’entretiens avec les associations professionnelles disciplinaires qui le souhaitent, dans l’objectif de confronter leurs approches respectives des grandes questions vives de la profession - incluant la réforme du baccalauréat et l’application de la réforme du collège, entre autres - et de rechercher des points d’accord. Le SNES-FSU était représenté par Sandrine Charrier, secrétaire nationale responsable du secteur "contenus", Virginie Pays et Claire Richet, responsables du groupe "professeurs documentalistes". Durant un peu plus de deux heures, nous avons échangé sur les différentes problématiques inhérentes au statut, aux missions des professeur.e.s documentalistes ainsi qu’à la question de l’information-documentation et de l’EMI.
Le constat partagé d’une profession fragilisée
Le SNES-FSU et l’A.P.D.E.N. ont été destinataires de témoignages, nombreux et convergents, de collègues exprimant des difficultés professionnelles importantes. Ces tensions fortes ne concernent pas seulement les obstacles au décompte de leurs heures d’enseignement conformément au décret sur les ORS (obligations reglementaires de service) : elles se cristallisent aussi autour d’un empêchement croissant à assurer, tout simplement, la mission d’enseignement. C’est particulièrement le cas en collège, où une régression du nombre moyen d’heures d’enseignement assurées par le.la professeur.e documentaliste depuis la réforme semble de plus en plus nette. Au lycée, l’actualité rend la situation particulièrement complexe et incertaine, sur des niveaux où les contenus d’enseignement ne sont pas formalisés pour le.la professeur.e documentaliste, malgré le principe d’une progression de la sixième à la terminale inscrit dans la circulaire de missions. Si certains collègues réussissent à maintenir des conditions d’enseignement effectives et à faire décompter les heures ainsi assurées, il semble qu’il s’agisse bien souvent de contextes particuliers et d’arrangements locaux, quand beaucoup s’autocensurent parallèlement pour conserver des conditions de travail correctes, en renonçant pour cela à leurs droits.
La refonte intégrale du cadre réglementaire de définition et d’exercice de la profession, et en particulier la parution si longtemps attendue de la nouvelle circulaire de missions en mars 2017, a été porteuse de grands espoirs, aujourd’hui déçus par l’impossibilité de faire appliquer les droits acquis de façon homogène et égalitaire. Les textes font l’objet, parfois des interprétations les plus fantaisistes, parfois d’un silence coupable de certains acteur.rice.s hiérarchiques, deux postures qui favorisent encore la désorientation des collègues, face à des textes qu’ils ne maîtrisent pas.
Ces difficultés accrues touchent un terrain professionnel déjà largement mis à mal par dix années de recrutements disparates et de formations initiale et continue hétérogènes, pour ne pas dire insuffisantes. Dans ces conditions, il est évident qu’une culture professionnelle solide et partagée manque cruellement, et rend toute action militante et revendicative extrêmement compliquée. De même, la fragilité de cette culture professionnelle induit chez certains collègues une posture marquée par une incertitude constante concernant leurs droits, mais aussi leurs compétences, et cette vulnérabilité se trouve encore augmentée par l’isolement.
Un mouvement de découragement et de lassitude semble ainsi amplifier la tendance au désengagement militant des collègues, qui touche les syndicats comme les associations, depuis plusieurs années déjà.
Des analyses communes dans l’action.
Au niveau institutionnel, Le SNES-FSU et l’A.P.D.E.N. estiment que la question de la formation, centrale, doit faire l’objet d’une prise en charge réelle et ambitieuse par les corps d’inspection, conformément à leurs missions, afin que l’offre à destination des collègues intègre le nouveau cadre réglementaire, et les contenus d’enseignement relevant de la responsabilité des professeur.e.s documentalistes. D’autre part, les questions statutaires d’application des textes relèvent de la DGRH ; leur positionnement se fait toutefois attendre, dans un contexte où l’autonomie des établissements est favorisée au point de rendre très délicat tout arbitrage national. L’A.P.D.E.N. précise, sur ce dossier, que les courriers adressés en juin aux services concernés n’ont pas obtenu de réponse, malgré une relance en septembre. Le SNES-FSU quant à lui, sera reçu en janvier par l’IGEN-EVS sur ces questions.
Concernant les conditions d’application des nouveaux textes réglementaires, l’A.P.D.E.N. et le SNES-FSU rappellent, si cela était encore nécessaire, que l’action de l’association et celle des syndicats ne sont en aucun cas exclusives l’une de l’autre : ce n’est qu’en complémentarité que nous pourrons parvenir à des avancées pour la profession. De même, les deux organisations, bien qu’elles soient conscientes de l’attente forte du terrain sur ces questions, considèrent que le changement de culture professionnelle nécessaire, à tous les échelons de la communauté éducative, pour permettre une application réelle et égalitaire des textes, prendra du temps. La période qui s’ouvre nécessite, plus que jamais, que les collègues, en établissement, disposent d’une bonne connaissance des textes, et l’A.P.D.E.N. et le SNES-FSU œuvrent déjà à la favoriser, via des interventions sur le terrain, auprès des collègues. Mais chacun.e a également, de manière individuelle, une part active à prendre dans cette démarche : se mobiliser, s’informer, interroger ses représentant.e.s élu.e.s est indispensable, pour ne pas se laisser abuser par les interprétations erronées et les arguments fallacieux qui entravent actuellement la réflexion professionnelle, pour construire une lecture commune et équilibrée des textes, et se montrer crédibles face à nos hiérarchies.
De même, nous insistons conjointement sur la nécessité de se référer strictement aux textes dans les situations de dialogue professionnel avec les IA-IPR et les chef.fe.s d’établissement. Il convient d’avoir bien conscience des conséquences que peuvent induire les arrangements locaux, lorsqu’ils sont proposés en amont d’un éventuel refus, par les collègues eux-mêmes : ces initiatives reviennent à admettre a priori le principe d’une déréglementation, là où la profession aspire à une application égalitaire des textes. Tout en concevant le principe de prudence et la logique pragmatique qui président vraisemblablement à ce type de démarche, et s’il est évident que la mise en application des textes ne pourra se faire que progressivement, nous insistons sur le fait que chacun.e doit conserver une posture professionnelle en accord avec sa fonction. Le.la chef.fe d’établissement a la responsabilité de faire appliquer les dispositions réglementaires, et dans ce cadre, c’est à lui.elle que revient de proposer d’éventuels « assouplisements » au texte (récupération partielle, IMP, HSE, récupération ponctuelle sous forme d’absences pour convenance personnelle...) dont le caractère doit rester provisoire, dans le cas où il.elle estimerait impossible de répondre favorablement à la demande d’application stricte qui aura été formulée par le.la professeur.e documentaliste, pour raisons de service.
Nous rappelons également aux collègues que ce type de négociation professionnelle doit respecter un certain nombre de règles, et être envisagé, autant que possible, dans une démarche collective : se faire conseiller et accompagner par les élu.e.s du personnel et/ou les représentant.e.s syndicaux.les doit (re)devenir un réflexe, et ce, dès les premiers stades des discussions. Cette approche collective pourrait par ailleurs limiter l’apparition de situations de harcèlement, qui touchent en ce moment, au delà des seul.e.s professeurs documentalistes, nombre de collègues dont la caractéristique commune est de se trouver, d’une manière ou d’une autre, isolé.e.s dans leur(s) établissement(s).
Il nous semble, plus globalement, important que chacun.e parvienne à se garder de la culpabilité professionnelle que favorise trop souvent la pénurie de moyens : à l’impossible, nul.le n’est tenu.e. Il s’agit de faire au mieux, au service des élèves, selon le contexte local et les moyens disponibles ; et s’il n’est pas possible d’assurer l’ensemble des missions de manière satisfaisante tout en se préservant, c’est bien la question des moyens qui devra faire l’objet d’une réflexion collective au sein de l’établissement (par exemple, au moyen d’une motion du CA demandant l’ouverture un poste supplémentaire), excluant toute remise en cause de la compétence du.de la professeur.e documentaliste.
Perspectives et revendications
Le SNES-FSU et l’A.P.D.E.N. portent conjointement la vision d’un métier équilibrant les trois axes de mission qui nous sont dévolues. L’action militante des deux organisations vise par conséquent une application raisonnable des dispositions réglementaires en vigueur, permettant aux professionnel.le.s d’assurer, de façon satisfaisante, l’ensemble des axes de mission constitutifs du métier.
Pour rappel, les deux organisations se rejoignent d’autre part sur des revendications portées depuis plusieurs années. La plus immédiatement prégnante actuellement concerne l’indispensable augmentation du nombre de postes de professeur.e.s documentalistes, à la hauteur des besoins induits par l’injonction de former de tou.te.s les élèves à l’information documentation, mais aussi par l’accumulation de tâches formulées dans les différents axes de la circulaire de missions. Malgré le signal extrêmement négatif adressé par le Ministère à ce sujet, avec la baisse massive des postes ouverts aux CAPES 2018, la question des moyens doit rester une revendication forte, afin de permettre à la profession d’assurer l’ensemble de ses axes de missions sereinement, au service des élèves qui lui sont confiés.
La demande de création d’une inspection spécifique, composée de membres issus de la profession, est tout aussi importante, corrélée à celle d’une agrégation. Elle s’appuie sur la conviction que la définition et la reconnaissance des contenus spécifiques d’un enseignement de l’information documentation pris en charge par le.la professeur.e documentaliste sont plus que jamais fondamentales, et doivent constituer, sur le long terme, le socle de l’action du SNES-FSU et de l’A.P.D.E.N.
Le SNES-FSU et l’A.P.D.E.N. considèrent en effet qu’il s’agit là de la voie évidente pour que les acquis du nouveau cadre réglementaire puissent enfin déboucher sur la reconnaissance pleine et entière d’une mission d’enseignement instituée pour les professeur.e.s documentalistes. L’EMI, telle qu’elle a été pensée et mise en œuvre par le ministère sur la base du principe de la transversalité, ne peut être envisagée comme une réponse à ces enjeux, bien que la contribution des professeur.e.s documentalistes y soit naturellement indiscutable. En cela, la position conjointe exprimée est conforme à celle que porte la formulation retenue par l’institution dans la nouvelle circulaire de missions : le professeur documentaliste enseigne l’information-documentation, et contribue, au prisme de son expertise particulière, à l’EMI, au même titre que les autres membres de la communauté éducative.
C’est cet enseignement de l’information documentation, explicitement reconnu par la circulaire de missions, qui doit à présent faire l’objet d’un travail collectif, incluant une réflexion prospective sur l’évaluation et sur les volumes horaires nécessaires, de nature à faire émerger des propositions concrètes pour une formation satisfaisante de tou.te.s les élèves. Le SNES-FSU et l’A.P.D.E.N. prévoient ainsi de se rencontrer à nouveau, dans le cadre de sessions de travail portant sur ces questions précises, afin de construire conjointement des propositions.
L’A.P.D.E.N. adresse ses remerciements à ses interlocutrices pour leur accueil, la qualité du dialogue engagé et la richesse des échanges tenus lors de cette réunion.