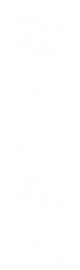Le socle de compétences, occasion de réinventer le métier d’enseignant ?
Comment penser que l’acte d’enseigner puisse ne pas évoluer dans un monde en plein mouvement ?
Jean-Michel Zakhartchouk
Professeur de collège en ZEP. Formateur à l’IUFM de l’académie d’Amiens. Membre de la rédaction des Cahiers pédagogiques (dont il a été rédacteur en chef pendant plusieurs années)
Publié dans le Médiadoc N°5, décembre 2010
Comment penser que l’acte d’enseigner puisse ne pas évoluer dans un monde en plein mouvement ? Comment penser qu’il puisse ne pas être remis en cause sous sa forme traditionnelle par l’irruption des nouvelles technologies, l’inflation des informations qui circulent si facilement pour le meilleur comme pour le pire, l’émergence de questions nouvelles (bioéthique, évolution du droit, problèmes du développement durable et des risques climatiques…) ?
Et pourtant, que les évolutions sont lentes ! Le cours magistral, quoiqu’on dise, règne toujours sous des formes plus souples, plus « light », mais reste dominant : le professeur est là pour « expliquer », « faire passer », « transmettre » à des élèves qui restent dans l’ensemble plutôt passifs. Bien sûr, j’entends dire le contraire et on sait que les plus conservateurs de nos collègues sont aussi ceux qui clament le plus souvent que « ils font déjà tout ça depuis longtemps » (à savoir rendre les élèves actifs, organiser un cours vivant, faire faire des recherches, des exposés, etc.). Or, il suffit d’une enquête minimale, à travers des rapports d’inspection, des interrogations d’élèves (y compris ses propres enfants) ou des observations empiriques pour constater qu’on est loin du compte. La collaboration avec le professeur documentaliste est d’ailleurs un signe : on ne se rend jamais au CDI dans certaines matières, on y va trop peu, passée l’initiation en sixième, ce qui permet au passage à des « mordus » comme moi de pouvoir amener facilement sa classe, vu qu’il n’y a pas surcharge dans le planning (« hélas ! » ajoute le militant pédagogique…).
Si on divise les activités pédagogiques en grands pôles, par exemple temps d’écoute, de production, de recherche, d’évaluation sommative, on voit très vite que l’écoute garde une prédominance qui augmente au fil du parcours scolaire. Le travail de groupes reste minoritaire et les exposés ne sont au mieux qu’un « supplément d’âme ». Il est toujours étonnant d’ailleurs de lire dans les pamphlets antipédagogiques ou dans des articles de presse peu informés que la « transmission » a disparu à force de mettre les élèves au centre et de les « rendre actifs ». Certes, ceux-ci participent davantage, mais l’enseignant continue à beaucoup parler, beaucoup plus qu’il ne le pense d’ailleurs, comme en témoigne l’écart entre l’estimation de ce temps de parole et la réalité, mis en évidence dans des expériences de cours filmés.
Or, la forme canonique du « cours » me paraît de plus en plus inopérante, y compris lorsqu’on a comme objectif de transmettre des connaissances de façon réelle et non de faire semblant dans un jeu hypocrite où l’on confond allègrement enseigner et apprendre. Car la transmission ne peut se réduire à la distribution d’informations, aussi bien faite soit-elle, elle passe par des dispositifs d’appropriation et par la mobilisation de compétences permettant cette appropriation. Et c’est là tout l’intérêt de la mise en place du socle commun de connaissances et de compétences que d’inviter à faire évoluer les formes d’enseignement. Je ne ferai ici qu’esquisser quelques-uns des changements forcément induits par ce socle si on le prend au sérieux bien sûr et s’il ne se réduit pas à des replâtrages de l’existant à coup de remplissage de cases en guise de nouvelles formes d’évaluation. Je m’appuierai sur quelques exemples de travail commun avec le professeur documentaliste.
Le socle commun oblige à établir des priorités. Qu’est-ce qui est vraiment « essentiel » et quels sont les critères pour le définir ?
Plus que jamais, des choix sont à faire pour distinguer ce qui est important de ce qui l’est moins. Plutôt que de se bercer dans l’illusion que plus on « livrera » des connaissances aux élèves et plus ils en retiendront (mais y croit-on vraiment ?), mieux vaut opérer des sélections dans l’immense champ des connaissances ou des savoir-faire et retenir ce qui est indispensable au citoyen du XXIe siècle. Et c’est vrai que la maîtrise de la lecture arrive nécessairement en tête. Savoir intégrer des stratégies de lecture selon l’objectif poursuivi, selon ses besoins, devenir un lecteur flexible, s’y retrouver dans la masse des écrits qui nous entourent, plus abondants que jamais avec les nouvelles technologies, voilà là des incontournables tellement plus importants que de savoir réciter nombre de savoirs vite oubliés. Travailler sur la « langue de l’école », avec ses mots abstraits, parfois faussement simples (« développer une argumentation », « problématique », « émettre des hypothèses »…) est tellement plus urgent que de s’encombrer de vocabulaire technique sans grand intérêt (je pense à ce lexique de la chevalerie ou à celui de l’architecture des églises médiévales qu’affectionnent trop les enseignants de cinquième, ou des listes sophistiquées de compléments circonstanciels en grammaire !).
Dans notre école, il est toujours risqué de proposer une sélection parmi les savoirs. On se fait vite taxer de partisan d’un sous-savoir dès qu’on l’envisage, mais dans la réalité, il faut bien choisir et quelquefois ce choix se fait par défaut, lorsqu’il ne reste plus beaucoup de temps en juin pour finir le programme. Un vrai tri sélectif, conscient et explicite, vaut bien mieux et le socle commun peut le permettre si on ose dire que « tout n’est pas important »…
La formule est sans doute galvaudée, mais on doit bien ici mettre en avant le fameux « apprendre à apprendre ». Une des compétences clés définies par le Parlement européen, qui n’a pas été reprise sous cette forme dans le socle commun, et on peut le regretter, mais qui reste malgré tout au cœur des différents piliers de ce socle. Si on prend encore une fois l’exemple de la lecture, il s’agit avant tout d’apprendre aux élèves à se poser les bonnes questions, à « apprendre à comprendre » comme le disent des chercheurs tels que Roland Goigoux ou Michel Fayol, en se demandant où il faut chercher la réponse, si on est dans l’explicite ou dans l’implicite, s’il y a besoin de survoler le texte ou s’il faut au contraire une lecture très minutieuse. L’enseignant devient alors ce « maître des codes » qui dévoile ceux-ci et forme au « décodage ». Car au fond, l’objectif de bonnes questions de lecture n’est pas forcément que l’élève y réponde, mais qu’il acquière les bonnes méthodes pour le faire, le processus étant, dans une phase de formation, primordial par rapport à la production.
Dès lors, les savoirs du socle commun ne sont pas ces « rudiments » qui constitueraient un sous-savoir trop basique, trop pauvre, mais les « éléments » qui permettent d’atteindre d’autres savoirs pour reprendre la belle distinction opérée par Claude Lelièvre. [1]
Les connaissances ne prennent du sens que si elles sont des ressources, des outils pour l’action ou l’activité intellectuelle, dans des situations complexes
Il est vrai que lorsqu’on travaille sur un projet, on peut très bien faire intégrer des connaissances pointues, qui pourraient paraître des « détails », mais celles-ci prennent alors du sens dans un ensemble où des liens apparaissent entre les savoirs. Prenons l’exemple d’un travail mené en cinquième en interdisciplinarité français-histoire avec implication forte du professeur documentaliste et l’utilisation des ressources du CDI, autour des Grandes Découvertes. Lorsqu’on fait écrire un carnet de bord d’un navigateur, on va chercher des informations très précises : comment on résolvait le manque de vitamines à bord, comment se passaient les longues journées sur le bateau, quelles étaient les raisons du voyage pour les marins, etc. Transformer un exposé sur Christophe Colomb en une narration à la première personne permet d’organiser autrement les diverses informations recueillies dans des livres, sur internet, dans un extrait de film, etc. On est davantage dans des moments « intensifs », rendus possibles justement parce qu’on a par ailleurs réduit le champ des savoirs enseignés.
L’une des tâches de l’enseignant doit être de créer des situations de mobilisation de compétences, en sortant du strictement scolaire, avec comme critère de pouvoir établir des liens entre les savoirs, par exemple entre la culture familière des élèves et la culture « classique », entre le passé et le présent. Toujours dans notre exemple, construire une affiche, exposée au CDI, sur les apports réciproques Europe/Nouveau Monde permet aux élèves par exemple d’apporter des produits alimentaires d’origine américaine (ne fût-ce qu’une pomme de terre !) en exploitant des ressources personnelles, qui peuvent être aussi l’énumération des noms de footballeurs mexicains ou brésiliens en relation avec leur origine lointaine.
Il est impératif dès lors, en formation notamment, de développer l’imagination pédagogique. Il suffit d’un rien pour transformer une situation qui encouragerait au copier-coller et au pensum scolaire et contraindre, par la vertu du dispositif proposé, l’élève à reformuler avec ses propres mots et faire preuve de davantage de créativité et d’inventivité.
**Quelques exemples :
- dans un travail bidisciplinaire impliquant le professeur documentaliste, les élèves devant faire un exposé sur le château-fort ont comme consigne d’imaginer que l’un d’eux est un guide touristique qui fait visiter tel château à des visiteurs, avec utilisation de projection d’images sur écran en fond. La recherche, du coup, s’oriente vers cette destination et prend un sens nouveau.
- dans un autre travail bidisciplinaire, les élèves doivent réaliser un exposé sur un animal migrateur, mais en se mettant dans la peau de cet animal (l’hirondelle ou le papillon monarque raconte son périple). Le travail en amont, la fiche technique nécessaire pour alimenter l’exposé prennent aussi un autre sens.
- dans un travail en français sur L’Odyssée, diverses recherches aboutissent à un abécédaire permettant à travers noms, verbes et adjectifs et en limitant les noms propres (solution de facilité) à brasser les grands thèmes de l’œuvre.
- la commande faite, en Histoire, à des élèves de présenter un petit diaporama sur un pays d’Amérique à partir d’une fiche-type mobilise aussi bien des connaissances que des compétences, y compris liées à l’informatique.
- dans un travail à venir autour du programme de géographie de cinquième, l’élaboration de petits textes personnels, autour de personnages imaginaires, mais basés sur la réalité socio-économique, permet d’incarner les questions de développement durable et d’intégrer des recherches précises à un projet d’ensemble.
- l’écriture d’une nouvelle d’écolo-science-fiction oriente des recherches sur les dangers du réchauffement climatique, nécessaires là encore pour nourrir le récit [2].
Le travail par compétences ouvre ainsi l’enseignement sur des dispositifs variés, incite à la créativité, ce qui ne peut qu’entraîner motivation et envie d’apprendre chez les élèves, même si on sait que ça ne suffit pas toujours…
Le travail par compétences conduit à évaluer autrement
On connait le risque : réduire le travail autour du socle commun et des compétences à un simple remplissage de livret en fin de troisième. Ou de faire emprunter aux enseignants la fausse piste de « l’évaluationnite », lorsque le temps d’apprentissage est sacrifié aux évaluations permanentes, et les compétences réduites à des microcompétences donnant lieu à une multitude d’exercices. On vient de voir l’importance des situations complexes, où on mobilise savoirs et savoir-faire sans un guidage trop fort de l’enseignant, où on se forme à l’autonomie, au risque d’échecs provisoires, normaux et inévitables. Il faut bien distinguer ici deux conceptions de l’acte d’apprendre. Une qui est fondamentalement béhavioriste : les élèves suivent un programme précis, avec micro-objectifs progressifs ; si le programme est bien conçu, ils ne doivent pas faire d’erreurs et on évalue leur parcours jusqu’au résultat final. L’autre conception est plus conforme à ce qu’on attend d’une approche par compétences. On part d’une tâche complexe et on recense tout ce dont on a besoin pour y parvenir. Certains aspects ne donnent pas lieu à évaluation et peuvent être négligés ou pris en charge par l’enseignant, car ils ne sont pas au centre de l’apprentissage voulu. C’est ainsi que l’orthographe ne sera pas prise en compte lorsqu’on forme l’élève à réaliser des « écrits de recherche » dans un livre de bord et on fournira une aide pour la syntaxe. Dans un travail au CDI où l’on doit dégager les caractéristiques d’un genre (par exemple le récit policier), on fera ou non chercher des livres sur les rayons (il m’est arrivé de diviser la classe en deux, selon le degré de maîtrise de compétences de recherches, y compris la rapidité, si importante dans ce domaine).
Le travail par compétences reconfigure l’acte d’évaluation. A l’enseignant de montrer qu’il s’agit surtout, dans la phase de formation, de donner des informations sur les progrès atteints ou à accomplir, sans négliger une fonction d’encouragement et de constitution de l’estime de soi, qui est un autre versant de sa tâche. J’ai fait souvent l’expérience de la difficulté pour les élèves de parler de leurs « atouts », de leurs « points forts » et lorsqu’on travaille davantage par compétences, ils déclarent plus facilement que cela les aide « à voir où ça ne va pas ». On est là dans une forte tradition culturelle française !
Insister plus sur l’évaluation formative, valider les progrès réalisés, prendre de la distance avec cette fameuse « constante macabre » dont parle André Antibi [3], voilà là encore un axe important du « métier à réinventer » [4].
Le socle commun insiste sur les attitudes et le but de l’enseignement est de permettre un développement de certaines de ces attitudes
Dans le socle commun, on oublie souvent le troisième tiers : les « attitudes », ou on les confond avec le « comportement », alors qu’il s’agit bien du rapport au savoir dont il est aussi question et dans notre perspective de formation citoyenne, le développement d’attitudes conformes à ce qu’on pourrait appeler après Meirieu la « probité intellectuelle » est également essentiel.
Ainsi, aider les élèves à trier les informations et surtout à s’assurer de leur fiabilité, introduire des degrés de fiabilité selon les sites internet consultés, trouver la bonne distance entre la méfiance devant les nouveaux médias et l’enthousiasme naïf, autant d’apprentissages indispensables que seule l’école est en mesure d’assurer pour certains élèves. Dans une recherche au CDI autour du yeti de Tintin au Tibet, nous avons pu ainsi faire la différence entre des sites « sérieux » et d’autres peu rigoureux qui nous montraient pourtant des « images filmées » de cet animal mythique. Voilà bien des tâches nouvelles pour l’école trop peu remplies pour l’heure… Dans une stimulante intervention au Centre Pompidou, Umberto Eco affirmait d’ailleurs que l’un des soucis majeurs au XXIe siècle est d’avoir la capacité à « filtrer » correctement l’information et à distinguer les informations sérieuses sur le Graal de milliers d’autres, fantaisistes, qui traînent sur des sites ésotériques. Et le rôle de l’enseignant est délicat, guetté par deux dérives :
- une vision très négative d’internet, qui survalorise le livre (les ouvrages à grand tirage reprenant par exemple les théories du complot pour « expliquer » l’histoire du monde, ne valent pas mieux que les sites qui répandent des rumeurs sur le 11 septembre. Ils ont juste un peu moins d’impact. Encore qu’il ne faut jamais oublier qu’internet produit très vite son antidote, aussi rapidement qu’a circulé d’abord la fausse information. Danger pour l’enseignant de diffuser la méfiance, qui n’est pas l’esprit critique, mais plutôt l’esprit de critique, très vivace chez nombre de nos élèves (« on nous ment »).
- l’attitude inverse est d’attendre tout d’internet et des recherches auxquelles on abandonne les élèves sans méthodologie et sans précautions. Il est vrai que l’attitude des enseignants eux-mêmes devant l’outil est déterminante. Sont-ils eux-mêmes d’abord des « vérificateurs d’information » rigoureux ? Et jusqu’où peut-on aller dans le scepticisme d’un côté, dans l’affirmation d’un argument d’autorité d’autre part ?
La partie « attitudes » du socle commun nous conduit en tout cas à réfléchir à ces questions et la formation à l’esprit critique devient également une priorité. D’autant plus urgente que l’école doit aussi préparer les élèves à affronter des questions sur lesquelles les réponses sont loin d’être stabilisées et où les incertitudes sont grandes. Certains, de façon à mon avis irresponsable, voudraient au fond que l’école ignore ces problèmes et se referme dans une neutralité aseptisée. D’autres trouvent au contraire bien trop timide l’introduction dans les programmes de ces « questions vives » ou de ces problèmes nouveaux où le savoir reste mouvant et pas totalement assuré. Je pense à l’éducation au développement durable, aux questions de bioéthique, aux nouvelles formes juridiques (propriété intellectuelle par exemple)… Il est vrai que traiter de ces questions en classe demande à la fois une réflexion « déontologique » et beaucoup de professionnalisme. Plus que jamais, l’enseignant doit apprendre à gérer un débat, à utiliser l’écrit comme prise de distance, à inventer des formes de travail de groupes et des règles à l’intérieur des groupes pour se mettre d’accord, etc.
Au centre de notre enseignement, une perspective de formation à long terme : quelle « nouvelle citoyenneté » ?
En fait, à l’heure des compétences, c’est tout le sens de l’acte d’enseigner qui est en jeu. Se contente-t-on de transmettre des connaissances, et à chacun ensuite de se débrouiller (et on sait alors l’importance qu’aura l’environnement socioculturel), selon une conception très libérale du métier que partagent y compris ceux qui par ailleurs se veulent pourfendeurs du « libéralisme », ou au contraire cherche-t-on à faire se construire des compétences utiles pour s’insérer de manière critique dans la société ? Si on prend trois compétences finalement marginales dans notre école : savoir travailler en groupes, faire un exposé devant un auditoire, mener une recherche de façon efficace, on voit en même temps qu’il s’agit là de capacités décisives dans le monde d’aujourd’hui.
Il est intéressant de voir que le CDI est un lieu où ce genre de compétences est travaillé plus que dans les salles de classe. Dès lors, la collaboration entre enseignants disciplinaires et documentalistes prend une importance toute particulière et dans le cadre du socle commun, la place de ces derniers doit être mise en avant, sans doute bien plus qu’elle ne l’est dans les textes officiels. Le documentaliste est alors pleinement un « enseignant » puisqu’il permet cette appropriation de savoirs, de savoir-faire, d’attitudes qui sont au cœur de ce qu’on peut attendre de l’école d’aujourd’hui et de demain.
L’acte d’enseigner dans sa diversité
Terminons, en reprenant sous une autre forme bien des points abordés ci-dessus, en indiquant finalement quelles sont les postures de l’enseignant qui permettent le développement de vraies compétences chez les élèves, tout en listant quelques problèmes, quelques « dilemmes » qui nous mettent bien du côté de la profession créative, où il n’existe pas de « prêt-à-penser » et de recettes magiques et non du côté du métier d’exécutant.
Que peut-on attendre d’un enseignant aujourd’hui ? Que devrait-on attendre ?
- d’être toujours bien sûr un « transmetteur », mais pour cela, des conditions sont à réunir, sans quoi « il n’y aura personne au bout du fil ».
- d’être un passeur culturel (ruser avec les cultures des élèves pour faire passer un peu de la Culture, d’où l’importance de la pédagogie (travail sur les représentations, techniques du travail de groupe, du débat...).
- d’être en fait un professionnel de l’apprentissage (l’autorité du metteur en scène de théâtre par exemple contre l’autoritarisme arbitraire qui n’est plus accepté. D’où l’importance de développer l’expertise, de savoir prendre les bonnes décisions (grâce à l’analyse de pratiques, et plus généralement l’attitude réflexive).
- un défenseur (ou mieux un promoteur) de valeurs démocratiques, de la laïcité moderne, en conciliant les invariants de la démocratie et les nécessités de la construction identitaire. D’où l’importance d’un apprentissage dans la formation de la complexité, l’ouverture aux sciences humaines, et peut-être l’ouverture à d’autres milieux (entreprise, monde associatif...) et la diffusion de recherches les plus diverses (ouverture aussi sur les autres systèmes éducatifs pour prendre du recul).
Il est probable que dans cette perspective, les professeurs documentalistes trouveront toute leur place, eux qui sont souvent de remarquables médiateurs et animateurs culturels dans l’établissement, qui doivent inventer des règles de fonctionnement à la fois contraignantes et suffisamment souples pour permettre les apprentissages de tous et de chacun dans sa diversité, qui doivent allier le professionnalisme en rapport avec des savoirs de référence et celui qui requiert des qualités pédagogiques, trop sous-estimées parfois par ses collègues ou par l’administration, alors qu’elles sont décisives, plus importantes que la maîtrise de l’informatique ou de la classification des ouvrages…
Il y a là d’ailleurs un vaste chantier pour la formation. Mais probablement, le développement du travail collectif dans les établissements permettrait de mieux valoriser les qualités de départ des enseignants, plus à l’aise dans telle ou telle posture (les organisateurs, les animateurs, ceux qui savent bien expliquer, ceux qui savent faire vivre un groupe, les géomètres et les saltimbanques…) afin que cette diversité ne soit pas brouillage mais recadrée dans une cohérence d’ensemble qui favorise du coup l’optimisation des « talents » personnels. Même si pour les enseignants aussi, un « socle commun » (de compétences) est nécessaire.
Tout cela ne peut se développer sans recours à une pensée complexe, sans entrer dans une « culture du paradoxe » et des « dilemmes »5.
Citons en quelques-uns : - Comment conjuguer bienveillance envers les élèves, leurs errements, leurs difficultés et exigence, en plaçant bien cette exigence sur le plan intellectuel et non sur celui des exigences formelles ?
- Comment concilier l’universel et le particulier ? comment aider chacun à se construire, individuellement, tout en accédant à une culture qui le dépasse (ou l’élève plutôt).
- Comment articuler apprentissages fondamentaux et acquisition d’une culture, sans se laisser bloquer par le piège du « préalable » ? Réflexion qui est au cœur du socle commun et du tri des savoirs évoqués plus haut. Il n’y a pas de réponse simple, entre le risque de renoncer au projet culturel faute de « bases » et la fuite en avant dans l’animation culturelle, dans les projets continuels au risque d’oublier certaines compétences clés autour du lire-écrire par exemple…
- Comment ne pas être un professionnel sans âme, comment ne pas être qu’un amateur de bonne volonté ? On a là tout le débat qu’on ne doit surtout pas trancher de manière binaire entre l’acte d’enseigner trop « cadré » et rationnel et un « feeling » qui ferait croire que l’expérience et le « don » sont les moteurs de l’enseignement, en oubliant la formation aux pratiques plus efficaces.
- Comment respecter les programmes, les normes et faire preuve constamment d’inventivité ? comment être un fonctionnaire qui met aussi l’imagination au pouvoir ?
- Comment développer une conception plurielle de la citoyenneté, à partir de valeurs démocratiques ? Comment ne pas confondre le vrai, le juste et le beau ?
- Comment former à affronter les problèmes de demain, tout en tenant compte de l’âge des élèves, des priorités, des exigences de laïcité ? C’est le problème posé d’ailleurs par la compétence 6 du socle commun qui engage l’enseignant, lui fait abandonner une neutralité mythique qui peut d’ailleurs être complaisance et refus d’aborder des problèmes essentiels de notre temps.
Bref, toutes ces interrogations peuvent redonner du sens au métier. Il est difficile, mais on peut nommer la difficulté « défi », et savoir qu’elle est inhérente à l’acte même de transmettre est finalement rassurant. Sauf si on manque d’ambition et si on se contente de « faire cours ». La tâche des pédagogues n’est-elle pas aussi de susciter l’envie de se plonger dans ce passionnant défi, bien sûr à la mesure de l’investissement de chacun. Encore une fois, le corps des documentalistes, moins marqué par le poids disciplinaire, par celui de la notation traditionnelle, de l’espace-temps habituel, peut jouer un grand rôle dans ces évolutions auxquelles nous sommes finalement nombreux à aspirer…
Notes
[1] voir par exemple sa contribution dans le dossier du n°439 des Cahiers pédagogiques sur le socle commun : « Ce qu’en pensait vraiment Jules Ferry »
[2] Ce projet est évoqué dans l’ouvrage de Jean-Yves Vilcot et Danièle Bazin : Vers une éducation au développement durable - Démarches et outils à travers les disciplines. CRDP d’Amiens, 2007 (Repères pour agir)
[3] Les notes : la fin du cauchemar ou « Comment supprimer la constante macabre ». Math’Adore, 2007
[4] Titre du livre que j’ai écrit en 2002, aux éditions Yves Michel