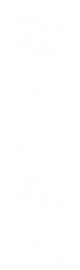De la culture informationnelle à la cyberculture : genèse d’un enseignement
En réponse à l’invitation qui m’a été faite de livrer mon expérience de l’enseignement de ces deux matières, je comptais initialement traiter mon sujet de façon plutôt historique et descriptive : exposer l’essentiel de chaque « culture », puis tenter de livrer quelques éléments relatifs aux « méthodes » des cours correspondants. Cependant, je tiens tout de suite à préciser que j’ai dû travailler, au fil du temps, beaucoup plus à mettre au point leur contenu théorique qu’à réfléchir à la façon de les enseigner. Je ne pourrai donc pas proposer grand-chose ici à ce sujet et ne répondrai par conséquent que très partiellement à ce que l’on m’a demandé. Je reconnais par là avoir un peu déplacé le problème en proposant ci-dessous une sorte de reconstruction dans l’après-coup du processus qui m’a conduit à concevoir et enseigner la culture informationnelle et la cyberculture. J’espère néanmoins apporter ainsi une contribution, même indirecte, à notre débat sur leur enseignement.
Ceci dit, il m’est apparu, au moment de reprendre l’histoire de cette élaboration, que l’ensemble des divers cadres où elle s’est effectuée a joué un rôle beaucoup plus important que je ne le pensais sur le moment. Car les contraintes inhérentes à ces cadres se sont manifestées sous forme d’une série de problèmes auxquels je me suis trouvé confronté et auxquels j’ai dû peu à peu trouver des réponses. Ces « effets de cadre » me paraissent maintenant intéressants à reconstituer, du fait qu’ils participent d’une sorte de genèse épistémologique de la culture informationnelle, puis du passage de celle-ci à la cyberculture.
Enfin, pour fixer rapidement le contexte, je rappelle que les enseignements en question se sont déroulés à Paris VIII sur une période assez longue, de 1994 à 2009. « Culture informationnelle » a ainsi fait partie du cursus de DESS « Documentation et Technologies avancées » du Département Documentation et du DEA « Enjeux sociaux et technologies de la communication » du Département Hypermédia. Puis, à partir de 1998, le titre en est devenu « Cyberculture ». Enfin, à partir de 2004, le DESS est devenue Master « Gestion de l’information et du Document » et le DEA, Master « NET » (Numérique : Enjeux, Technologies).
Article de Claude Baltz, Professeur émérite, Université Paris 8
Equipe « Paragraphe », paru dans le médiadoc n°6 Avril 2011
Effet de cadre, premier niveau : enseigner les SIC [1] en Documentation ?…
Lorsque j’intègre en 1993 le Département « Documentation » (Doc en abrégé), la demande qui m’est adressée est claire et, rétrospectivement, tout à l’honneur de celles qui en ont eu l’intuition [2] . Elles ont saisi en effet que la formation des « gens de documentation » devait s’ouvrir, au-delà des techniques documentaires traditionnelles mais également de la formation aux diverses TIC [3]. Car il commençait à être perceptible que ce qu’on appelle d’ailleurs toujours, faute de mieux, la « Documentation », occupe un rôle stratégique dans toute organisation (ce qui me permettra de rédiger 10 ans plus tard « Quand la Documentation s’éveillera » [4] ). D’où le problème fondamental, d’origine socio-économique, à savoir qu’il devenait primordial de créer une ouverture théorique dans les cursus d’enseignement (conséquence évidente des phénomènes mondiaux d’ouverture, dans tous les domaines). Ce qui ne pouvait a priori pas signifier autre chose que : formation aux SIC. Et ne serait-ce, formellement d’abord, que parce que les formations documentaires occupent de fait une place reconnue depuis longtemps dans le cadre universitaire des SIC (du côté de l’ « information », faut-il d’ailleurs le rappeler, et pas de la « communication »…). Mais aussi parce que cette insertion n’est évidemment pas dénuée de sens puisque, au-delà des enseignements traditionnels de l’indexation, du catalogage, de l’informatique documentaire, etc, l’idée s’était quand même déjà faite peu à peu que tout le domaine universitaire et professionnel concerné tournait à sa façon autour de la notion d’information.
Cependant, la nature d’un enseignement SIC en Doc n’était pas évidente à déterminer. Car, au-delà du contenu à devoir ainsi élaborer, se posait d’abord un problème d’hétérogénéité du public concerné. En effet, le choix était déjà ancien dans le Département que les étudiants inscrits en Licence puissent provenir de toutes les disciplines avec, comme conséquence évidente, l’absence quasi générale de tout bagage en SIC. D’où le problème institutionnel : il fallait certes pallier cette lacune et assurer un minimum d’homogénéité mais, en même temps, on ne pouvait, dans une formation « préprofessionnelle » aux volumes horaires déjà lourds, que leur proposer l’ « essentiel » des SIC. Ce qui n’est pas une mince affaire, quand on sait que l’identité de cette discipline reste toujours aussi problématique et que vouloir pincer son essentiel relève un peu de la gageure… Intervient aussi le statut (presque) impossible des gens de documentation : en tant que futurs praticiens de la documentation économique, médicale, juridique, etc., ils doivent en effet pouvoir, dans l’idéal, dialoguer avec toutes les disciplines, sans être spécialistes d’aucune… et il fallait en plus leur ajouter une « couche SIC » !?…
Or, quand on est spécialiste de rien, surtout quand on a été « aux écoles », on se doit au moins d’avoir un « vernis »…sinon même une culture. Nous y voilà ! Peu à peu s’est ainsi formée l’idée que, plutôt qu’un contenu spécifique, il s’agissait d’essayer de faire prendre une « culture SIC » chez les nouveaux venus. Avec une formation en deux ans, le premier volet était finalement assez simple à concevoir : du fait qu’il est difficile de concevoir une « culture » sans histoire, l’année de Licence se trouva ainsi dotée d’une vingtaine d’heures de cours « Histoire et épistémologies de l’information ». Sous l’hypothèse forte des effets culturels de tout enseignement historique, était donc proposé aux étudiants un panorama sommaire des différentes « théories de l’information » (mais aussi de la communication). Panorama assez tordu, on peut cependant le noter car, sans remonter forcément à Platon, mais au moins depuis l’essor technologique du 19ème et ses premières implications théoriques, l’approche purement historique ne peut que très vite se mâtiner d’une problématique épistémologique : quels sont en effet les rapports entre les différentes disciplines (sociologie, psychologie, sciences politiques, etc.) et la nouvelle venue SIC qui ne peut, elle, qu’annoncer le programme vertigineux, sinon impérialiste, de traiter des phénomènes d’information et de communication dans leur ensemble ! Enfin, à travers ce panorama historico-épistémologique, j’essayais d’introduire, au gré du hasard des questions posées, quelques questions plus contemporaines, comme par exemple : produit informationnel ?... simulation ?... interactivité ?... technologies mentales ?... société d’information ?… Sans compter la lancinante question toujours en embuscade : c’est quoi l’information ?… En somme, une sorte de « bouillon de culture », qui préparait la suite.
Entre histoire et vue d’ensemble, c’est donc bien une distillation culturelle qui était ainsi à l’œuvre, bien plus que l’apprentissage du détail de telle ou telle théorie. On conçoit donc ce premier effet de cadre : j’étais parti pour donner une formation d’ « appoint » relative à un « contenu SIC » mais les diverses contraintes évoquées ci-dessus m’ont mené assez vite à devoir déboucher sur un point de vue essentiellement assumé comme « culturel » (indépendamment de l’idéal selon lequel tout enseignement est censé d’abord dispenser une culture… « ce qui reste quand on a tout oublié... »).
Effet de cadre, deuxième niveau : émergence de la « culture informationnelle »
Le premier étage à peu près ébauché, restait ensuite à concevoir le suivant, du cours de DESS/DEA, en notant tout de suite qu’il autorisait plus de matière, avec un module annuel de 37,5 h. et qu’il s’est tout de suite appelé « culture informationnelle ». Il est difficile, et peut-être pas fondamental ici, de reconstituer le détail historique de sa genèse. Par contre, deux effets de cadre sont intéressants à dégager pour saisir la logique de cette genèse : le premier lié à la nature de l’ouverture théorique recherchée, le second à l’insuffisante réponse des SIC.
La pertinence de la perspective d’ouverture à la base du cours de Licence se vérifiait déjà alors de plus en plus mais il était évident qu’il fallait encore préciser ses modalités et ceci malgré une situation un peu paradoxale. Car les TIC commençaient à entrer avec fracas dans toutes les activités professionnelles et personnelles et, chez beaucoup de formateurs, la tentation était donc grande de vouloir à tout prix suivre un mouvement, qui n’a fait que s’accélérer depuis. Dans ce mouvement, bien entendu, les enseignements du Département n’ont pas cessé d’être modernisés et technicisés. Mais cela n’a pas atteint notre certitude d’une nécessaire ouverture théorique, bien au contraire. Il nous paraissait clair en effet que les gens de documentation devaient à tout prix éviter de se perdre dans la frénésie technologique. Rétrospectivement, je dirais qu’ils devaient être capables d’y « voir clair » (ou, au moins : un peu clair…) dans la nature des TIC, leurs usages, leurs effets, leurs enjeux...
Un exemple sommaire devrait ici suffire. L’apparition des intranets, dans les années 90-95 a vite donné lieu à une importante littérature technique et gestionnaire. Mais, sans en renier l’importance, l’hypothèse qualifiable en contrepoint de « culturelle » consistait à « voir » d’abord tout intranet comme une tentative de greffe d’une sorte de système nerveux sur une organisation. Ce qui amenait à développer, les problèmes de prothèse technologique soulevés par Mc Luhan par exemple, puis les difficultés cognitives et sociales correspondantes, l’analyse de l’information ainsi disponible, les jeux du concept polymorphe de réseau, etc. La métaphore du « système nerveux » reste certes discutable mais son mérite est de permettre, par exemple au documentaliste qui doit accompagner un intranet, de disposer ainsi de quoi prendre du recul, avoir une vue d’ensemble, comprendre les enjeux socio-informationnels en cause et discuter sur des bases équilibrées avec l’informaticien en charge de l’implantation.
On l’aura compris, le terme « vision » devenait ainsi fondamental dans la conception de l’ouverture théorique recherchée. Ne pas se noyer dans le tourbillon technologique suppose en effet qu’on dispose d’une vision de la situation. Le futur cadre professionnel jouait donc ici en injectant la nécessité de tels moyens de vision pour des étudiants qui n’auraient pas à traiter de l’aspect technique des choses mais devaient concevoir l’implantation des systèmes d’information. Si l’on ajoute que le terme « culture » était alors dans l’air du temps et qu’il véhiculait de surcroît un sens englobant, permettant de rassembler des éléments a priori plus ou moins disparates, se profilait ainsi l’hypothèse d’une relation intime entre vision et culture (quitte à généraliser plus tard ces deux notions dans la « cyberculture »). On notera aussi que s’introduisait de fait la notion d’ « effet de culture » (ou de vision) : on ne voit plus de la même façon (une œuvre d’art ou un intranet…) quand on est « cultivé », autre façon de résonner à ce qui commençait à circuler concernant les effets économiques et sociaux de la culture (NB : ce qui n’est pas y réduire toute culture !)
Une vision portant sur des entités informationnelles (et/ou communicationnelles), pour des professionnels de l’information, et à une époque où commençait à faire débat la « société d’information »… il n’y a donc pas trop lieu de s’étonner rétrospectivement que le nouvel enseignement, presque dans la foulée et sans savoir trop pourquoi, se soit appelé « Culture informationnelle », le premier de ce genre, à ma connaissance, dans l’espace universitaire. De façon plus générale, il faut aussi comprendre que c’était un moyen de dépasser les acceptions les plus courantes - et encore grandement en vigueur - du terme « société d’information ». Car il me paraissait évident que ladite société ne pouvait plus continuer à être essentiellement comprise en fonction de la quantité d’objets techniques conçus et mis en vente sur le marché. Au contraire, son évolution devenait à un moment donné de plus en plus dépendante de la vision qu’ont ses membres du phénomène de l’information, sinon même d’un minimum de construction théorique à ce sujet. D’où l’aphorisme : « pas de société d’information sans culture informationnelle ».
Le terme en question était certes rassembleur, bien que son contenu fût encore assez hétéroclite : il fallait bien avancer, au sens d’un bricolage à la Levi-Strauss... Sans détailler, en voici quelques têtes de chapitre, pour donner une idée : « Penser inforcom [5] (signe, entropie, compactage, métaphore, complexité…), « Milieux » (média, propagations, interfaces…), « Problématiques techniques » (codes, mémoires, numérique, interactivité, système-expert…), « Visions, attitudes mentales » (observation, délocalisation, hybridation…), « Gestion » (politique informationnelle, systèmes d’information, coût de l’information, statistique…), « Evolution/enjeux » (prothèses diverse, rôle de l’image, matière intelligente, société d’information…), etc.
Un bénéfice indirect mais fondamental de ce nouveau point de vue était qu’il permettait de doter les gens de documentation de ce qui leur manquait fortement jusque là, à mon sens du moins, à savoir une forme d’identité théorique, du fait qu’ils devenaient possesseurs d’une culture spécifique et formulable. Et ainsi, au-delà de leurs compétences traditionnelles et de leur sensibilité propre à l’information et au document, leur outil de travail principal doit peut-être commencer à être compris comme la possibilité de mobiliser cette culture informationnelle. Le terme d’ « analyse informationnelle » pourrait d’ailleurs être convoqué ici, de la même façon que la qualité d’un économiste est d’être capable de traduire sa culture théorique en une analyse économique.
Cette culture faisait évidemment d’abord la différence avec celle, directement technique, de la « tribu » des informaticiens/télécoms, concepteurs et aménageurs des TIC, suffisamment lestés par leur propre matière .pour s’y cantonner sans trop d’états d’âme culturels. Mais elle les distinguait aussi des « tribus SIC » (sommairement parlant : gens de médias, relations publiques, agences de presse, publicité, relations humaines, etc.). Ceux-ci en effet, et surtout à cette époque où l’internet et la numérisation n’avaient pas encore vraiment amorcé leur grand brassage, étaient plutôt spécialisés sur des médias et/ou des pratiques déterminés, avec des démarches, dans l’ensemble, plutôt descriptives et/ou critiques.
Et c’est ici qu’a dû jouer un deuxième effet de cadre. D’un côté, face au bouillonnement technologique, le besoin émergeait du côté de la Documentation, d’une analyse approfondie des nouveaux phénomènes d’information et de communication. Par contre, du côté SIC, il me paraissait que la réponse théorique à cette nouvelle situation restait d’une densité très faible. En effet, après avoir tâté en Licence de l’histoire des théories SIC, que proposer ensuite aux étudiants ? Sémiologie, analyse de tel ou tel média, analyse des usages des technologies, critique des stratégies industrielles ?… Malgré l’intérêt spécifique de chacun de ces thèmes, il me semblait que les SIC n’apportaient pas d’outils conceptuels satisfaisants, et surtout pas une vue d’ensemble. C’est donc aussi à cause de cette insuffisance SIC que s’est confortée l’idée d’élaborer une réponse théorique sous forme d’une construction « culturelle ». Je ne résumerai pas ici un processus qui débouchera, on va le voir, sur la notion de « cyberculture » et n’évoquerai à ce sujet qu’une formulation que j’avais très tôt cru utile de proposer : « Cela, que nous supposons être la difficulté essentielle des SIC, explique la méfiance qu’elles suscitent : elles ne peuvent pas être une science, ontologiquement, parce qu’elles doivent être plus qu’une science : une science et une culture. Car les « gens d’information et de communication » ne sont pas seulement les utilisateurs d’objets théoriques et de méthodes, comme dans les disciplines classiques : ils ont en permanence à regarder l’effet sur le monde de leurs objets et des pratiques correspondantes » [6].
C’est sur ces deux effets de cadre que s’est donc conçu progressivement le cours de culture informationnelle. La seule manifestation publique un peu conséquente de ce phénomène propre à Paris VIII, en plus de quelques articles sur ce thème [7]. , a été l’organisation d’un colloque en 1997 [8] , époque d’ailleurs, à laquelle le cours a changé de titre, comme on va le voir.
Effets de cadre, troisième niveau : émergence de la cyberculture
Malgré une première structure encore assez hétéroclite, on l’aura peut-être saisi, la petite amorce de panorama esquissée plus haut aura permis au lecteur, je l’espère, de se faire un début d’idée sur le contenu de la culture informationnelle et d’y constater aussi l’intention manifeste de donner aux étudiants une solide formation conceptuelle, plus précisément : leur permettre de disposer des éléments théoriques permettant de déceler une unité de sens derrière la diversité des situations pratiques qu’ils pourraient affronter à terme. Mais, assez vite, le fait de disposer du chapeau unificateur « culture » est apparu insuffisant, sous trois nouveaux effets de cadre :
- - Cadre logique (ou épistémologique). Le saut théorique était déjà important pour accepter de développer en tant que tels les thèmes que j’ai vite nommés des « nœuds conceptuels » (par exemple : interactivité, réseau, interface, information, forme, identité, etc.). Mais la question se posait en même temps de leur mode de présentation et donc du type de relations logiques à attribuer à leur ensemble. On pouvait certes déjà noter que cet ensemble conceptuel pourrait à l’évidence se voir doté d’une structure hypertextuelle, permettant ainsi un accès attractif à la culture en cours d’élaboration. Mais, on le sait bien, même si elle traduit bien l’état épistémologique d’un monde au savoir éclaté, une telle structure ne gomme pas magiquement le besoin profond d’une unité d’ensemble (indépendamment du fait que la réponse à ce besoin n’est pas toujours facile ou possible selon les domaines). Problème, donc : la culture informationnelle pouvait-elle être dotée d’un statut un peu unificateur, autorisant précisément une compréhension d’ensemble ? Ou fallait-il se résoudre à enseigner ces nœuds dans un relatif désordre et selon une structure logique plus ou moins bancale ?
- - Cadre politique, maintenant : l’explosion des TIC a rapidement suscité une double réaction. D’un côté, on ne pouvait que constater le phénomène de diffusion à grande échelle de ces technologies et surtout, phénomène nouveau, celui de leur irradiation foudroyante chez les jeunes. Mais, en même temps, on commençait à s’inquiéter à la fois des vitesses de diffusion différentes selon les milieux (ce qui devait déboucher sur la « fracture numérique ») et des utilisations sociales discutables ou insuffisantes des TIC. C’est ainsi que peut se synthétiser rétrospectivement « Cyberculture », paru en 1997, l’ouvrage phare de Pierre Lévy pour notre propos, où se développait la question des modalités d’une appropriation citoyenne des TIC. Et, comme il s’y traite essentiellement du rapport individuel et social aux technologies, on peut avancer que Lévy y détournait ainsi politiquement la résurgence du terme « cyber », tel qu’il se manifestait dans la remise au goût du jour de la cybernétique de Wiener, partie de la Côte ouest, à partir des années 90.
- - Cadre social, enfin : alors que se concrétisait la nécessité d’une ouverture théorique traitée à Paris VIII, comme on l’a vu, en termes de « culture informationnelle », commençait parallèlement à apparaître à cette époque dans les milieux de la Doc un phénomène qualifiable ici, par pure commodité, de « pédagogique » ou « didactique ». On peut dire que, là où Lévy insistait sur l’appropriation des technologies, les gens de documentation insistaient sur celle de l’information, ce qui est bien compréhensible : c’est l’air qu’ils respirent… Emergeait ainsi la question d’un savoir documentaire et des moyens de l’enseigner et de le tester (passeports BII ou CII, par exemple). L’ouvrage de Brigitte Juanals, « La culture de l’information » , quoique paru un peu plus tard, synthétise bien cette évolution, que l’on peut compléter, entre autres, par les travaux plus récents de l’équipe d’Alexandre Serres et Eric Delamotte . Il convient d’ailleurs de remarquer la jonction théorique ainsi opérée avec le courant américain de l’ « information literacy », né dans les années 70 et structuré dans les années 90. Il est clair cependant que, lorsque le terme « culture » y est ainsi évoqué, c’est essentiellement autour des modes d’accès à l’information, avec comme horizon d’induire éventuellement « une culture générale (prise dans le sens d’instruction, de savoir), une connaissance des médias, une prise en compte de considérations éthiques et une intégration sociale dépassant largement une compétence documentaire et informatique » (B. Juanals, op. cit. p. 25), où l’on retrouve ainsi les préoccupations de Lévy, mais dans le cadre plus spécifiquement informationnel.
- Ces trois effets de cadre ont alors infléchi la première mouture de la culture informationnelle en injectant des problèmes nouveaux :
- - Apparition du préfixe « cyber » : médiologiquement parlant, « cyberculture » est plus court que « culture informationnelle », ce qui n’est pas un mince avantage... Et si l’inconvénient du terme est qu’il connote quand même la « quincaillerie » cybernétique, il possède finalement un avantage décisif… En effet, dans une société a priori surinformante comme la nôtre, le problème de l’orientation est devenu déterminant : d’où l’hypothèse que l’individu a besoin d’être doté d’une vision spécifique pour se piloter (« cyber », préfixe du mot grec « gouvernail ») dans sa dépendance fondamentale à l’information. Le changement de titre devenait donc sous ce point de vue une nécessité quasi ontologique. Et l’on peut avancer ainsi que la cyberculture en tant que moyen fondamental d’orientation devient une sorte de « driver social » : « pas de société d’information sans cyberculture ».
- - Côté contenu, après avoir remarqué que l’usage même récent du terme « culture informationnelle » ne renvoie guère à un contenu précis, reste à traiter, comme on l’a dit, la question d’une organisation unificatrice relativement à sa multiplicité de nœuds conceptuels, une sorte de « menu racine » en quelque sorte... En fait, la solution m’était apparue depuis quelque temps déjà, assez simple finalement, mais surtout comme traduction immédiate de l’ « être-au-monde informationnel » qui constitue désormais notre horizon commun. Autrement dit : en poussant à ses extrêmes, l’idée que nous sommes totalement dépendants d’information pour exister. Je ne développerai pas ici la structure de référence de tout processus informationnel, telle que j’ai déjà commencé à l’approcher, en divers textes (en attendant une publication d’ensemble sur ce thème de la cyberculture) :
- − le sujet-pas-encore-informé doit d’abord s’extraire de son lieu spatial et/ou mental ;
- − ce faisant, il découvre l’espace extérieur, à tous les sens du terme, en même temps que le phénomène de médiation concrétisé par le terme générique de « machine de vision » : l’ensemble de tous les moyens cognitifs et techniques par l’usage desquels on peut aller toucher les choses et les milieux du monde pour s’ « informer » à leur sujet. Point fondamental, ces machines sont susceptibles d’une classe très large de réglages, matériels et cognitifs ;
- − à travers ce qu’il soutire à travers ce contact/communication, le sujet peut donc devenir « informé » (provisoirement…), l’entité « information » étant essentiellement à concevoir comme variationnelle sur divers types d’espace, mentaux pour commencer ;
- − hypothèse encore mal reçue, parce que trop « idéaliste » : l’information peut exercer des effets (même « matériels »), à condition de bien déterminer le cadre épistémologique nécessaire ;
- − l’ensemble des processus précédents contribuent en permanence à sécréter le cyberespace.
La formation théorique jusqu’ici nommée « culture informationnelle » s’est alors trouvé posséder sous ce point de vue une cohérence logique forte qui lui manquait au début. On peut ainsi s’appuyer sur une structure extrêmement générale que l’on retrouve sous un mode fractal à tous les niveaux, et bien plus puissante que la structure basique des SIC : émetteur/canal/récepteur/feed-back. Il devenait ainsi possible de rapprocher de façon compréhensible l’extrême diversité des nœuds conceptuels évoqués ci-dessus. Ce qui n’empêche pas d’admettre par ailleurs qu’ils peuvent convoquer un très grand nombre de disciplines. Par exemple, la notion si essentielle de mémoire ne peut se comprendre sous l’angle d’une gestion documentaire sans faire lien avec celles d’image, d’identité, de rapport au temps, etc. Traiter cette situation ne fait que traduire l’explosion des frontières actuelles du savoir et implique entre autres la nécessité, surtout pour les gens de documentation, de concevoir de nouveaux rapports de type non encyclopédique à ces nouveaux registres du savoir (j’ai évoqué à ce sujet le terme de savoir « hyperfractal » impossible à développer ici, reposant évidemment sur la maîtrise d’outils de navigation informationnelle)
Enfin, la connexion de la culture informationnelle avec les nouvelles préoccupations de type « information literacy » oblige à considérer deux types de problèmes :
- − Le mode opératoire de la cyberculture est certes encore problématique, dans la mesure où elle n’est bien avancée que sur les diverses composantes théoriques d’une vision adaptée au nouveau monde. Cette construction est vraisemblablement indispensable malgré la complexité de sa mise en œuvre. Mais ce que rappellent maintenant aussi à juste titre les tenants de la didactique, c’est que sa pertinence théorique n’est garante ni de ses modes de diffusion ni de la réceptivité de ceux auxquels elle est destinée, au moins en principe. Ceci signifie que la cyberculture doit être complétée sur le plan pratique. Pour juste esquisser un programme, il s’agit donc de développer les éléments de la « vision infocom » et, sur cette base, les outils du pilotage informationnel, individuels et sociaux. Pour faciliter les choses, il est également possible de mettre en forme une sorte de « Bible », recueil structuré d’aphorismes divers du genre « L’information n’est évidente que pour celui qui la possède » ou encore « Pas d’information sans communication…et vice-versa », etc. Leur formulation concentrée et plus ou moins imagée doit permettre, en particulier, d’assurer dans des milieux encore débutants, une imprégnation plus facile, malgré un contenu théoriquement complexe derrière les apparences.
- − Ce qui précède a finalement un pendant épistémologique important : comment concevoir les rapports entre SIC, cyberculture, culture informationnelle ? Il est clair que la cyberculture au sens sommairement esquissé ci-dessus devient, de mon point de vue, un noyau théorique fondamental des SIC. Elle devrait peut-être leur permettre ainsi d’assumer leur véritable statut c’est-à-dire, comme esquissé plus haut, d’être essentiellement une culture, assurant la mise en forme d’outils de vision, théorique et pratique. Et ceci, au lieu qu’elles se vivent comme un conglomérat peu satisfaisant d’emprunts divers aux autres disciplines (sociologie de l’information, sémiologie, etc.), au prétexte épistémologiquement douteux qu’elles traiteraient, elles, de l’information, de la communication et de leurs technologies, alors qu’en fait toutes les disciplines sont maintenant dans ce cas. Peut-on alors se risquer à avancer que l’on ne voit plus très bien ce qui justifie l’autonomie des SIC en tant que telles actuellement, sauf si elles admettent d’interroger à fond l’être-au-monde informationnel et se recentrer ainsi sur ce que je considère comme leur identité (et peu importe qu’elles en viennent à s’appeler « cyberculture » ou autrement). Et il est clair enfin que cet étage théorique complexe se doit d’être préparé et étayé par des étages de formation à l’accès à l’information et à sa maîtrise, tels que les gens de documentation ont commencé à les concevoir, on l’a dit, depuis une dizaine d’années.
Pour conclure, je n’ai plus guère le loisir ici de m’étendre longuement sur mon expérience d’enseignement en tant que telle. Si ce n’est qu’elle se caractérisait, on l’aura compris par une forme d’ « improvisation raisonnée », sur fond de programme de cours très structuré, d’attention très forte aux questions soulevées dans l’amphi, et par un souci en même temps très réduit de « tenir le programme », l’essentiel me paraissant être l’espèce de « choc épistémologique » suscité chez les étudiants par l’alliage de développements parfois très abstraits et de considérations très pratiques relativement à la diversité infinie des situations d’information et de communication.
Et, globalement, ils avaient l’air d’en être assez contents… même assez longtemps après, pour autant que j’ai eu à en connaître.
Annexe bibliographique
À titre de complément, je me permets d’indiquer quelques textes personnels qui ont jalonné le parcours sommairement analysé ci-dessus.
– Plan détaillé des cours « Culture informationnelle » et « Cyberculture ». Polycopié. Dépt. d’Information-Documentation. Paris 8
– « Le concept de culture informationnelle ». Actes du colloque de l’Interassociation ABCD : Pour une culture de l’information. De la documentation à l’information. 1995
– « Une culture pour la société de l’information ? Position, définitions, enjeux ». In Documentaliste, n°2. 1998
– « Cyberculture : un driver pour la société d’information ». Actes du Congrès de la FADBEN. 2005.
– « CYB, SIC, DOC ». in Les cahiers de l’ingénierie éducative, N° 57. 2007
Notes
[1] Sciences de l’Information et de la Communication
[2] Annette CATTENAT, Directrice du Départementt, Christine POITEVIN, Isabelle WERTEL-FOURNIER
[3] Technologies de l’Information et de la Communication
[4] In « Documentaliste ». n° 6. 2003.
[5] Contraction commode des termes « information » et « communication » (NB : le « r » du début a fini par tomber, puisque l’on dit maintenant « infocom ») »
[6] « Courte réflexion sur une possible particularité épistémologique des SIC : vers une culture informationnelle ? ». In Le concept d’information, essai de définition. Actes du 3ème Congrès de la FADBEN. Marseille. Octobre 1993
[7] Cf. annexe bibliographique
[8] Pour une culture informationnelle. Journée d’études organisée par les Dépt. Documentation-Hypermédia de Paris 8, avec les concours de l’ADBS et de la DISTNB (Direction de l’information scientifique et technique et des Nouvelles Bibliothèques, Ministère de l’Education Nationale, de la Recherche et de la Technologie). Participation de : Eric Allart (IBM France), Claude Baltz, Daniel Confland (DISTNB), André Geoffroy (France Télécom), Alain Lebaube (Le Monde), Hervé Seyriex (Délégué interministériel à l’insertion des jeunes), Bernard Stiegler.